Un très grave accident s'est produit début 2014 dans un site d'enfouissement de déchets nucléaires aux Etats-Unis.
A l'heure actuelle la situation n'est toujours pas maîtrisée par les autorités locales. Cet accident valide l'opposition à l'enfouissement profond des déchets nucléaires, comme il est prévu de le faire à Bure dans la Meuse.
Voici une synthèse de cette affaire, réalisée par le collectif "Bure Stop"
Début février 2014, incendie d’un camion de transport de sel à moins 650m sous terre. Une semaine plus tard une contamination radioactive avec de l’américium et du plutonium ((de type alpha) est détectée en surface. Malgré une filtration haute efficacité de la ventilation, des rejets à l’extérieur du site se sont produits. La zone 7 du site est à l’origine de ces émissions. Des employés sont testés positifs à une contamination radiologique interne. Le site est fermé, les nouveaux déchets déroutés vers un autre site de stockage temporaire, malgré l’hostilité de certains élus locaux.
Certains riverains inquiets ont déploré le retard de transmission d’information de la part des autorités et le manque d’information indépendante. Une contamination à grande échelle est même évoquée dans la presse du Nouveau-Mexique, dans un bassin de 14 millions d’habitants. Des employés sont envoyés très progressivement, il faudra plus de deux mois et demi pour arriver à la zone endommagée. L’accès aux déchets est toujours très problématique du fait de la contamination.
Trois mois plus tard, début mai 2014, la raison de l’accident n’est toujours pas connue : réactions thermiques dans plusieurs fûts de déchets entre un oxydant et un réducteur ? Sont annoncés de 18 mois à 3 ans de fermeture du centre d’enfouissement.
S’il y a un problème de stabilité de ces déchets conditionnés, qu’en-est-il des déchets stockés dans les autres parties du stockage qui sont déjà fermées ?
ET SI CELA REMETTAIT CIGEO/BURE EN QUESTION ?
Impossible de ne pas faire le parallèle avec Cigeo, le « très grand frère » du WIPP (garanti à l’origine pour 10 000 ans et stoppé au bout de 15 ans). Au WIPP, 96% des déchets sont des FAVL (Faible Activité à Vie Longue). A BURE, il s’agit de déchets très irradiants, inapprochables. Et le souci réaction oxydant/réducteur (bitumes/nitrate d’ammonium par exemple) est posé de façon cruciale par les déchets MAVL (Moyenne Activité à Vie Longue) qui y sont prévus en très très grande quantité.
Mais quels décideurs et politiques vont-ils enfin prendre enfin conscience que rassembler des fûts de déchets nucléaires aux fond de boyaux inaccessibles au moindre problème, c’est rassembler tous les ingrédients pour une catastrophe environnementale ?

En complément à cette information, voici un appel à agir contre le projet CIGEO d'enfouissement de déchets nucléaires, projet qui se heurte à une vive résistance de militants et d'habitants de la région.
Bure : c’est dans ce petit village de la Meuse que l’industrie nucléaire veut enfouir ses déchets les plus dangereux, qui resteront radioactifs pendant des millions d’années.
Dernière étape avant la phase industrielle, un pseudo "débat public" s’est tenu en mai 2013, mais a été un véritable fiasco. La Commission chargée de mener ce débat est allée d’échec en échec face à la mobilisation des opposants : les réunions ont toutes été reportées ou annulées, et la commission a tenté de sauver les meubles en modifiant le format du débat et en organisant des réunions secrètes dans les villages proches de Bure, sans en faire la publicité par voie de presse ou internet. En février 2014, la Commission Particulière du Débat Public a rendu ses conclusions sur le "débat" sur Cigéo, le site d’enfouissement des déchets les plus radioactifs et préconise le report du calendrier. Pour le Réseau "Sortir du nucléaire", qui avait boycotté ce débat sur un projet imposé, il est urgent d’abandonner Cigéo !
Le 1er juin 2014, l’assemblée antinucléaire Grand tEst a lancé la campagne BURE 365. Un appel à une année d’actions contre l’enfouissement des déchets, le nucléaire et son monde, dans le but de faire connaître et d’amplifier la lutte contre le projet CIGEO. Le Réseau "Sortir du nucléaire" soutien et relaie cet appel.
Rejoignez la campagne BURE 365 en organisant une action près de chez vous ou en accueillant une date d’info-tour !

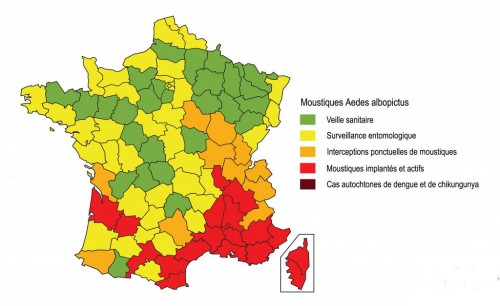








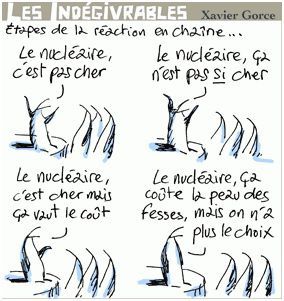 Il est regrettable que la Cour des Comptes se soit interdit d’enquêter sur une comparaison des coûts entre nucléaire et énergies renouvelables, celle-ci ayant pu se révéler fort instructive. Le nucléaire est en effet la seule technologie au monde dont les coûts de production vont croissant, malgré des dépenses de recherche qui ont crû de 10% en 3 ans, alors que le coût du MWh renouvelable ne cesse de baisser. Il faut s’attendre à un croisement imminent des courbes des prix de production, notamment avec l’éolien terrestre. Un rapport allemand publié par le think tank Agora Energiewende a d’ailleurs récemment montré qu’un mix électrique à base de solaire et d’éolien s’avèrerait
Il est regrettable que la Cour des Comptes se soit interdit d’enquêter sur une comparaison des coûts entre nucléaire et énergies renouvelables, celle-ci ayant pu se révéler fort instructive. Le nucléaire est en effet la seule technologie au monde dont les coûts de production vont croissant, malgré des dépenses de recherche qui ont crû de 10% en 3 ans, alors que le coût du MWh renouvelable ne cesse de baisser. Il faut s’attendre à un croisement imminent des courbes des prix de production, notamment avec l’éolien terrestre. Un rapport allemand publié par le think tank Agora Energiewende a d’ailleurs récemment montré qu’un mix électrique à base de solaire et d’éolien s’avèrerait