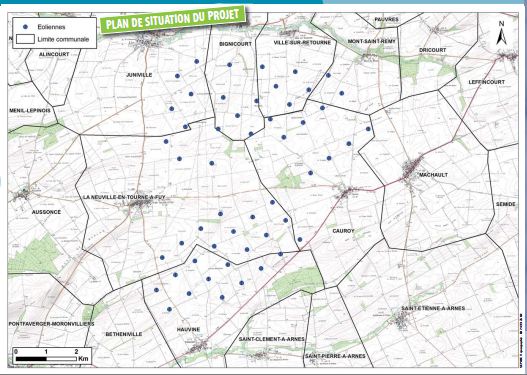Le Conseil d’État vient de rendre sa décision sur l’arrêté de classement des espèces « nuisibles » contre lequel France Nature Environnement et Humanité et Biodiversité avaient déposé un recours commun.
Cet arrêté, pris en 2012 par le ministre de l’Ecologie, concerne une dizaine d’espèces (mammifères et oiseaux) et autorise leur destruction par piégeage ou par tir dans certains départements ou certaines communes.
Le Conseil d’Etat a jugé que ce classement n’était pas justifié dans une vingtaine de cas et il a annulé l’arrêté en ce qui concerne :
- la pie dans l’Aube, l’Aude, le Calvados, la Dordogne, l’Isère, la Marne, la Seine-et-Marne et le Rhône,
- la fouine dans la Dordogne, l’Eure-et-Loir, l’Isère, la Seine-Maritime et le Rhône,
- la martre dans le Calvados, la Dordogne, la Lozère et la Moselle,
- la corneille dans l’Aude et les Pyrénées-Orientales,
- le geai dans le Var,
- la belette dans le Calvados.
La décision du Conseil d’État est applicable dès sa publication : ces espèces ne peuvent donc plus être piégées ni détruites dans ces départements, sans qu’une modification de l’arrêté ministériel soit nécessaire.
France Nature Environnement et Humanité et Biodiversité se félicitent de cette décision, qui sanctionne des classements abusifs. « Le concept de « nuisible » n’a pas de sens en biologie », indique Christophe Aubel, de Humanité et Biodiversité, « car toutes ces espèces jouent un rôle utile dans les écosystèmes. En particulier, les petits prédateurs (fouine, martre et belette) sont des auxiliaires précieux de l’agriculture car ils contribuent à réguler les populations de rongeurs ».
Dominique Py, administratrice de France Nature Environnement en charge de la faune sauvage poursuit : « Au-delà de cette décision du Conseil d’État, c’est l’ensemble de la réglementation sur les « nuisibles », concept périmé, qui devrait être revu pour prendre en compte les réalités biologiques et privilégier les méthodes préventives, afin de mettre un terme aux destructions injustifiées de dizaines de milliers d’animaux sauvages chaque année ».
France Nature Environnement et Humanité et Biodiversité poursuivront leurs actions de plaidoyer auprès du ministère en faveur d’une modernisation de cette réglementation.

Geai des chênes







 De la France aux Etats-Unis, en passant par l'Allemagne, les pays qui ont misé sur l'énergie nucléaire se trouvent aujourd'hui confrontés à un nouveau défi : le démantèlement de leurs centrales vieillissantes ou définitivement mises à l'arrêt. Voici quarante ans, leurs concepteurs, tout à leur enthousiasme, n'avaient pas prévu que, devenus trop vieux et donc dangereux, ces réacteurs devraient être un jour démontés, et qu'il faudrait stocker leurs déchets hautement radioactifs. Si les opérateurs et les autorités de la sûreté nucléaire assurent pouvoir maîtriser ce processus de démantèlement, la réalité est tout autre.
De la France aux Etats-Unis, en passant par l'Allemagne, les pays qui ont misé sur l'énergie nucléaire se trouvent aujourd'hui confrontés à un nouveau défi : le démantèlement de leurs centrales vieillissantes ou définitivement mises à l'arrêt. Voici quarante ans, leurs concepteurs, tout à leur enthousiasme, n'avaient pas prévu que, devenus trop vieux et donc dangereux, ces réacteurs devraient être un jour démontés, et qu'il faudrait stocker leurs déchets hautement radioactifs. Si les opérateurs et les autorités de la sûreté nucléaire assurent pouvoir maîtriser ce processus de démantèlement, la réalité est tout autre.