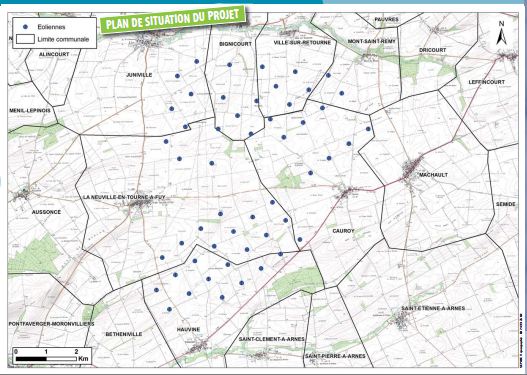La crise économique qui touche l'économie mondiale depuis plusieurs années est loin d'être terminée.
La croissance est pratiquement nulle en Europe, et la dette qui plombe la reprise ne diminue pas. Les chiffres du chômage sont un indicateur tristement évident de la gravité de cette crise qui touche des millions de personnes rien qu'en France. Pourtant, on apprend que les dividendes versés aux actionnaires sont en forte hausse cette année. Selon le site lesechos.fr : "Les dividendes, au niveau mondial, ont atteint un nouveau record au deuxième trimestre à presque 427 milliards de dollars, selon une étude d'Henderson Global Investors sur les plus grandes sociétés mondiales."
On est encore plus surpris de voir que notre pays est parmi ceux qui voient le chiffre des dividendes versés augmenter le plus. Toujours selon lesechos.fr : "La France se distingue clairement, puisqu'elle est le plus important pays de la zone pour les rémunérations aux actionnaires. Celles-ci atteignent 40,7 milliards de dollars entre avril et juin, en progression de 30 %. Le secteur financier a opéré un retour à la normale avec la reprise des dividendes de Crédit Agricole et une forte hausse pour Société Générale. BNP Paribas, de son côté, a versé des dividendes et indiqué qu'il continuerait malgré la lourde amende infligée aux Etats-Unis."
D'après ces chiffres, on pourrait conclure que la crise est terminée, puisque des bénéfices peuvent être versés aux actionnaires. La réalité semble plus cruelle : les entreprises hésitent à investir, car la situation économique n'est pas brillante, et elles préfèrent distribuer leur bénéfice plutôt que prendre le risque de se développer en misant sur un meilleur avenir.
Cette hausse des dividendes n'est donc pas une bonne nouvelle, du moins pour la majorité des Français, car elle n'annonce d'aucune manière un début de sortie de crise.





 ce qui relativise grandement l'ampleur de la fraude. De plus, la CAF récupère environ 90 % de cette fraude détectée. Il existe forcément par ailleurs une fraude non détectée, mais par définition son montant est inconnu, il est cependant estimé à quelques centaines de millions d'euros par an.
ce qui relativise grandement l'ampleur de la fraude. De plus, la CAF récupère environ 90 % de cette fraude détectée. Il existe forcément par ailleurs une fraude non détectée, mais par définition son montant est inconnu, il est cependant estimé à quelques centaines de millions d'euros par an.