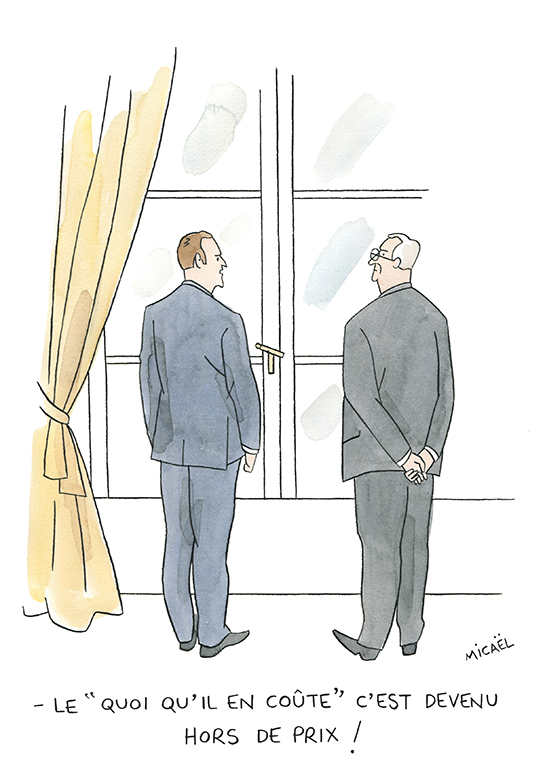L’article 6 du projet de loi relatif au respect des principes de la République, en débat au Parlement, oblige les associations comme les syndicats sollicitant une subvention publique à signer un « contrat d’engagement républicain ». Si elle était adoptée, cette obligation, d’apparence formelle, serait lourde de conséquences et affaiblirait gravement notre démocratie et nos libertés fondamentales.
Le texte prévoit un engagement « à respecter les principes de liberté, d’égalité, de fraternité, de respect de la dignité de la personne humaine ainsi qu’à respecter l’ordre public, les exigences minimales de la vie en société et les symboles fondamentaux de la République ». Il ne s’agit pas ici de se conformer à un nouveau cadre légal car tout individu comme toute organisation se doivent de respecter les lois et la Constitution. Sinon, le juge est saisi pour sanctionner les illégalités et les délits constatés. L’objectif n’est pas là. De plus, la Charte des engagements réciproques signée en 2014 entre l’Etat, les collectivités territoriales et les associations a déjà réaffirmé ces principes partagés.