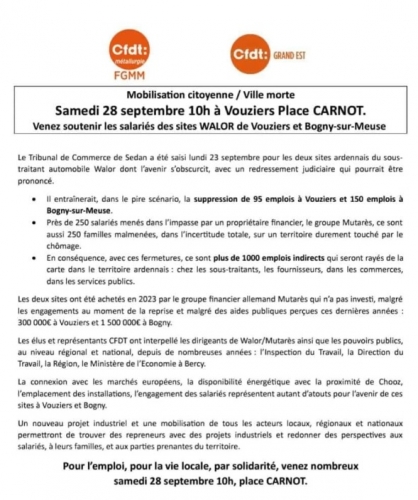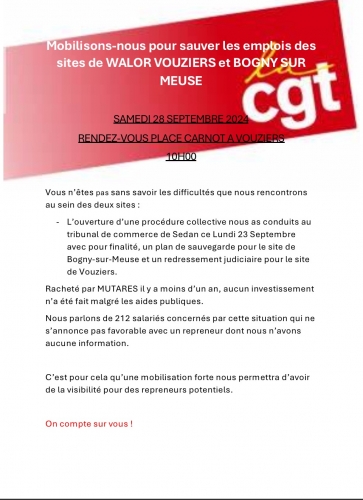L’aide médicale de l’Etat (AME) subit de nouvelles attaques politiques et médiatiques. Nos organisations alertent sur les conséquences désastreuses qu’entraîneraient de nouvelles limitations du dispositif, déconstruisent les contre-vérités agitées par ses détracteurs et décryptent le contenu du dernier rapport des services d’inspection générale de l’Etat, dirigé par Claude Evin et Patrick Stefanini (décembre 2023).
1. Qu’est-ce que l’AME et qui en bénéficie ? – Un dispositif à l’accès restrictif
L’AME est une prestation d’aide sociale financée par l’Etat, qui permet aux personnes en situation administrative irrégulière d’accéder aux soins dans l’attente d’obtenir leur régularisation. Elle est soumise à plusieurs conditions restrictives : être sans titre de séjour ; prouver sa résidence irrégulière en France depuis au moins 3 mois consécutifs (elle n’est donc pas accessible dès l’entrée sur le territoire) ; déclarer des ressources inférieures à 847 € / mois pour une personne seule (un montant bien en-deçà du seuil de pauvreté de 1158€ / mois).
Concrètement, le dispositif concerne les sans-papiers les plus précaires, majoritairement des travailleuses et travailleurs informel·les du secteur du soin, de la construction, de la restauration ou encore de la livraison.
Ce ne sont pas les fraudes et les abus qui caractérisent l’AME, mais le manque d’information qui entraîne du non-recours et de la difficulté pour les personnes concernées à faire valoir leurs droits.
- L’enquête « Premiers Pas » (2019) de l’Institut de Recherche et de Documentation en Economie de la Santé montre que le taux de non-recours à l’AME atteint 49 %. Après 5 année ou plus de résidence en France, 35 % des personnes sans titre de séjour n’ont pas ouvert leurs droits à l’AME.
- L’enquête de MdM et de ses partenaires associatifs (avril 2023) recense les obstacles administratifs qui compliquent l’accès : insuffisance des lieux de dépôt, obligation de prise de RDV, conditions d’accueil inadaptées…
Décryptage : de nouvelles restrictions des conditions d’accès à l’AME envisagées dans le rapport Evin-Stefanini auraient des impacts considérables :
- La « conjugalisation des ressources » c’est-à-dire la prise en compte des ressources du conjoint dans le calcul d’admission à l’AME, ce qui n’est pas le cas aujourd’hui, priverait de toute couverture santé de nombreuses personnes, tout en accentuant les situations de dépendance conjugale pour les femmes étrangères en situation de grande précarité
- La limitation des pièces justificatives d’identité aux seuls documents avec photo, ainsi que le dépôt physique des demandes de renouvellement au guichet, complexifierait des procédures déjà compliquées, et conduirait à des retards voire des renoncements à ce droit, tout en alourdissant le travail des caisses d’assurance maladie.
- La limitation de l’accès à l’AME aux personnes concernées par une mesure d’éloignement constituerait un dangereux mélange des genres en subordonnant les impératifs de protection de la santé publique aux considérations de contrôle migratoire.
L’ensemble de ces mesures risqueraient donc de priver de couverture maladie de nombreuses personnes, qui seraient contraintes de renoncer à se soigner et verraient leur état de santé se détériorer, et plus globalement celui de la population. En Espagne, la restriction de l’accès aux soins des étrangers en situation irrégulière votée en 2012 a entraîné une augmentation de l’incidence des maladies infectieuses ainsi qu’une surmortalité des sans-papiers de 15% en 3 ans. Cette réforme a finalement été abrogée en 2018 face aux conséquences humaines et sanitaires dramatiques.