Communiqué d'Amnesty International le 13/11/2014
Malgré la mobilisation d’Amnesty International et les 8 340 signatures collectées en France, La société Dow, géant américain de l'industrie chimique, s'est de nouveau dérobée à la justice en ne répondant pas à une convocation d'un tribunal indien le 12 novembre 2014.
DOW CHEMICAL SE DÉFAUSSE
Cette convocation s’inscrit dans le suivi des conséquences de la terrible fuite de gaz survenue en 1984 à Bhopal. Cette catastrophe a fait des milliers de morts et causé chez un très grand nombre de personnes des maladies chroniques et invalidantes.
"La société Dow Chemical fait un nouveau pied de nez aux dizaines de milliers de personnes atteintes par la pire catastrophe industrielle de l'histoire de l'Inde. Malheureusement, cette absence de sens des responsabilités n'a rien de surprenant, quand on a l'expérience de longues années de dénégations de la part de Dow.Les autorités de l'Inde et des États-Unis doivent déployer davantage d'efforts pour que Dow se conforme aux demandes des juridictions indiennes. »
Shailesh Rai,
Directeur des programmes pour Amnesty International Inde.

DÉNI DE RESPONSABILITÉ
Depuis 13 ans, Dow rejette toute forme de responsabilité vis-à-vis des victimes et des rescapés de Bhopal. Dans un courrier envoyé à Amnesty International plus tôt dans l'année, un membre de la direction de Dow a affirmé que les tentatives d'impliquer directement cette société dans des poursuites judiciaires en Inde étaient « dénuées de fondement » et s'est efforcé de dissocier la société Dow de sa filiale Union Carbide Corporation (UCC), dont elle est propriétaire à part entière.
En 2001, Dow a racheté UCC, une multinationale américaine propriétaire majoritaire de l'entreprise qui exploitait l'usine de Bhopal à l'époque de la fuite. UCC ne s'est pas non plus rendue à plusieurs convocations devant des juridictions indiennes pour répondre d'infractions qui lui sont imputées en rapport avec la catastrophe.
La présente assignation - la troisième signifiée à Dow, le 4 août 2014 - indiquait sans ambiguïté qu'il revenait à Dow, propriétaire d'UCC à part entière, d'amener cette entreprise à répondre des faits qui lui sont reprochés. Le tribunal a décidé qu'une nouvelle assignation serait émise le 22 novembre, l'audience étant programmée au 14 mars 2015.


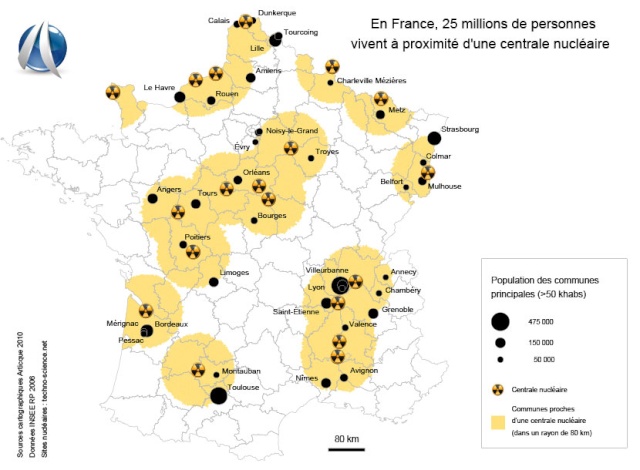



 L’ABC est au final un outil d’aide à la décision pour les élus et de l’ensemble des acteurs de la commune, qui permet d’intégrer dans un projet de territoire, les questions de biodiversité. Il concourt ainsi activement à la construction d’un développement soutenable et au service de la population.
L’ABC est au final un outil d’aide à la décision pour les élus et de l’ensemble des acteurs de la commune, qui permet d’intégrer dans un projet de territoire, les questions de biodiversité. Il concourt ainsi activement à la construction d’un développement soutenable et au service de la population.  L’éolienne des enfants du projet des "Ailes des Crêtes", outre l’objectif de production d’énergie, a une visée symbolique et pédagogique : en s’impliquant, la génération actuelle lègue un patrimoine durable en matière d’énergie à la génération future. Ainsi les parents, grands-parents, parrains d’un enfant peuvent par un geste fort montrer leur volonté d’un futur où l’énergie est propre et propriété de tous.
L’éolienne des enfants du projet des "Ailes des Crêtes", outre l’objectif de production d’énergie, a une visée symbolique et pédagogique : en s’impliquant, la génération actuelle lègue un patrimoine durable en matière d’énergie à la génération future. Ainsi les parents, grands-parents, parrains d’un enfant peuvent par un geste fort montrer leur volonté d’un futur où l’énergie est propre et propriété de tous.