30 ans d’existence. L’ONG Memorial était un pilier dans la défense des droits humains. La Cour suprême russe a ordonné sa liquidation. Une décision honteuse.
Le verdict est tombé le 28 décembre : l’ONG Memorial ne sera plus. Cette fermeture d'une ONG emblématique en Russie est une attaque directe contre les droits à la liberté d'expression et d'association. Dès le lendemain, le 29 décembre, la justice russe a liquidé son organisation sœur, le Centre Memorial de défense des droits humains.
En liquidant l’ONG Memorial et son Centre de défense de droits humains, les autorités russes poursuivent leur inlassable répression de la société civile.
Une ONG phare
Fondée en 1989, notamment par le prix Nobel Andreï Sakharov, Memorial International était l'une des organisations de la société civile les plus respectées de Russie. Quand au Centre de défense des droits humains de Memorial, il avait été fondé en 1991. Le cœur de mission de Memorial était de préserver la mémoire des victimes des violations des droits humains durant la période soviétique.
L’ONG a travaillé pour documenter la répression politique et les atrocités perpétrées sous le régime de Joseph Staline et d'autres dirigeants soviétiques. Memorial a compilé la plus grande base de données sur les victimes de persécutions politiques de cette époque.


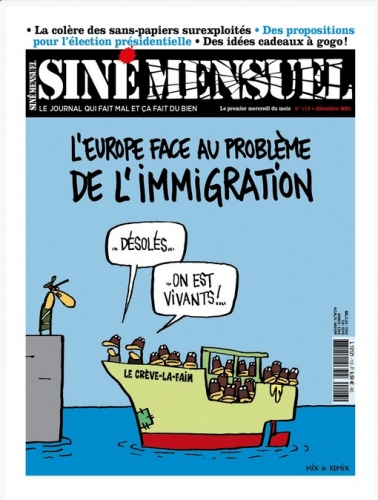
 Sud Ardennes, longue de 110 km.
Sud Ardennes, longue de 110 km. 
