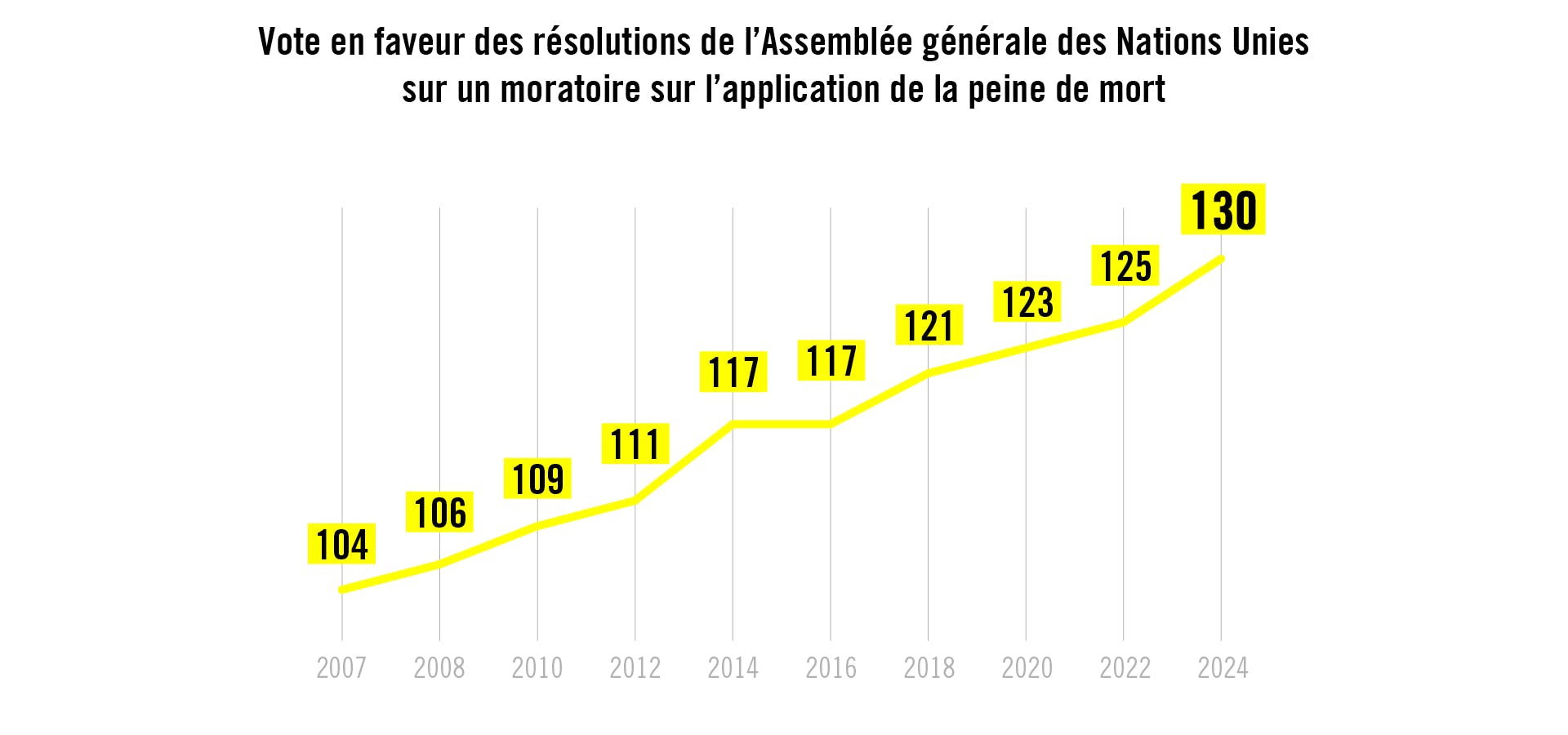Contribution de la LDH aux Assises de lutte contre l’antisémitisme
Née de la lutte contre l’antisémitisme et l’arbitraire de la raison d’Etat, la LDH (Ligue des droits de l’Homme), a toujours veillé à dénoncer ce qui cédait à cette idéologie haineuse et meurtrière, d’où que cela vienne, et à inscrire pleinement ce combat dans le cadre général de son engagement pour les valeurs que porte la République. C’est pourquoi elle se félicite de l’initiative prise de relancer les Etats généraux de lutte contre l’antisémitisme, dont elle souhaite qu’ils puissent contribuer à élargir le cercle de celles et ceux qui, au sein de la société civile, dans les médias, parmi les partis et les élu-e-s politiques, considèrent qu’il y a aujourd’hui urgence à réagir, à agir et, surtout, à construire sur le temps long.
Dans le contexte d’une recrudescence marquée des actes antisémites et racistes au dernier trimestre 2023, qui s’est prolongée durant toute l’année 2024, il est tout à fait regrettable que la mise en œuvre du Prado, le Plan national de lutte contre la haine et les discriminations, ait été freiné, le contexte national ne pouvant tout expliquer. De même, le long délai mis à nommer une personne à la tête de la Dilcrah a contribué à brouiller d’une part le caractère prioritaire de la lutte contre l’antisémitisme et le racisme et d’autre part, la nécessaire continuité des efforts que cela suppose.
Le fait que les premiers ministres successifs, Gabriel Attal et Michel Barnier aient, tous deux, refusé dans les faits de recevoir le dernier rapport annuel de la Commission nationale consultative des droits de l’Homme (CNCDH) de lutte contre le racisme, l’antisémitisme et la xénophobie a envoyé un mauvais message, que la LDH déplore. Cet évitement, sans précédent, n’a en effet pas contribué à clarifier, aux yeux de l’opinion publique, l’engagement de l’exécutif dans un contexte national, européen et mondial inquiétant.
L’augmentation de manifestations antisémites s’inscrit dans une montée plus globale de la haine de l’Autre, dont le juif est historiquement l’une des figures paradigmatiques. La LDH y a réagi dès ses premières manifestations – rappelons, pour mémoire, les polémiques créées autour de Dieudonné, que la LDH a fait condamner pour négationnisme – et a toujours répondu présente lorsqu’il s’est agi de faire front contre l’antisémitisme sous toutes ses formes, et contre les entrepreneurs en haines identitaires qui en favorisent l’émergence et en banalisent les expressions.
Le paysage politique français – mais ce n’est hélas pas une exclusivité de la France – est en effet de plus en plus dessiné par des personnalités, des partis et des médias qui, chacun à leur façon, remettent en cause la notion même d’égalité des individus entre eux et le caractère universel que doit avoir l’accès aux droits fondamentaux qui , entre autres, l’éducation, la santé, le logement. La revendication d’une « préférence nationale » en est une des expressions les plus connue. Elle chemine logiquement aux côtés de la notion de « grand remplacement ». Toutes deux œuvrent, non sans succès, dans le débat public, légitimant une désignation de boucs émissaires pour tous les maux dans la société, exonérant toute autre cause des difficultés vécues par les gens. Les succès électoraux du Rassemblement national, les alliances de fait avec une large partie de la droite, la multiplication sans fin de textes de lois visant les « sans-papiers » et l’escalade sécuritaire, verbale et réelle, participent d’une même volonté de ramener l’identité des gens à des « races », des religions et de stigmatiser l’altérité ainsi définie…
C’est ainsi qu’on a vu ces dernières années prospérer une résurgence d’un antisémitisme parfois ouvert, parfois sournois, toujours virulent. Les éloges de la « politique juive » autoritaire de Napoléon Ier, du « sauvetage des juifs » par le maréchal Pétain, la stigmatisation du choix de lieux de sépultures en Israël des enfants de l’école Ozar ont accompagné une litanie tragique de meurtres et d’attentats.
Cette utilisation politique et médiatique des problématiques identitaires, instrumentalisée dans le débat public, contribue largement à nourrir une grille de lecture racialiste d’une société qui serait d’abord composée de communautés, réifiées et opposées. De même, est affirmée une « identité française » aux frontières culturelles et mentales figées qui postule l’exclusion hors de la communauté nationale de celui ou de celle qui ne remplirait pas tous les critères. Rien de tel pour nourrir haine et affirmations réciproquement exclusives. Les juifs n’y échappent pas, à qui les antisémites continuent, avec constance, de reprocher une soi-disant « double allégeance ».
Lire la suite