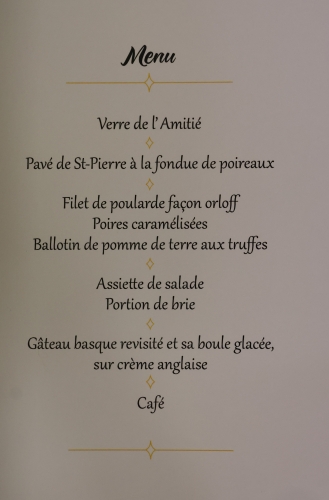Communiqué de ATD quart monde, publié le 23.01.2026
- Pourquoi la pauvreté continue-t-elle de déterminer, dès l’école primaire, des trajectoires scolaires dégradées et souvent irréversibles ?
Après six années d’une recherche participative menée dans une douzaine d’écoles maternelles et élémentaires, ATD Quart Monde présente les résultats de la recherche CIPES – Choisir l’Inclusion Pour Éviter la Ségrégation à l’Académie des sciences le 24 janvier 2026.
UN CONSTAT DOCUMENTÉ ET DÉRANGEANT[1]- 72,1 % des élèves en SEGPA et 80 % des élèves en ULIS sont issus de milieux défavorisés.
- En SEGPA, 5 % seulement des élèves sont inscrits au Diplôme national du brevet, 1 % l’obtient.
- Neuf ans après l’entrée en 6e SEGPA, 37 % seulement des élèves ont obtenu un CAP, souvent non choisi.
- Ces orientations produisent une ségrégation scolaire durable et contribuent directement à la reproduction de la grande pauvreté.
- UNE RECHERCHE INÉDITE PAR SA MÉTHODE
- La recherche CIPES a reposé sur des travaux menés conjointement par des chercheurs, des enseignants et des militants Quart Monde ayant l’expérience de la grande pauvreté et avec le soutien des partenaires (syndicats, AGSAS, mouvements pédagogiques et fédérations de parent d’élèves). Observations de classes, entretiens avec des élèves et des personnels des écoles, questionnaires enseignants et projets conduits dans les écoles ont fait l’objet de temps de réflexion en commun. C’est cette démarche participative qui a permis d’interroger les savoirs et les pratiques.