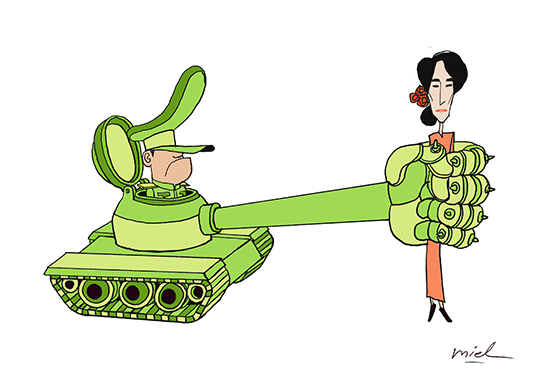Publié le
La présidence française de l’UE qui commence le 1er janvier a été préparée en étroite collaboration avec les grandes entreprises françaises et leurs lobbys. C’est ce que révèle un nouveau rapport de l’Observatoire des multinationales, partenaire de basta!.
Le 1er janvier 2022, la France va prendre la présidence du Conseil de l’Union européenne, pour six mois. Un nouveau rapport de l’Observatoire des multinationales, partenaire de basta!, et de l’ONG bruxelloise Corporate Europe Observatory révèle que celle-ci a été préparée avec les industriels français et leurs lobbys. « Même si la présidence française de l’UE ne débute qu’en janvier 2022, ses préparatifs ont commencé de nombreux mois auparavant, rappelle le rapport. Les recherches menées montrent que depuis le début du processus, la collaboration étroite entre les autorités françaises et les grandes entreprises a été la norme. »
Sur les 13 rendez-vous divulgués par le représentant permanent de la France à Bruxelles, le haut-fonctionnaire Philippe Léglise-Costa, dix se sont tenus avec « des grandes entreprises ou des lobbies industriels, contre un seul avec la société civile ». Des 26 rendez-vous divulgués par son adjoint, 18 étaient avec des grandes entreprises ou des lobbies industriels, contre un seul avec la société civile. Philippe Léglise-Costa fréquente les arcanes européennes depuis plus d’une décennie : il avait été nommé adjoint du représentant permanent sous le mandat de Nicolas Sarkozy, puis conseillé François Hollande sur les questions européennes, avant d’être nommé à ce poste par Emmanuel Macron en 2017.