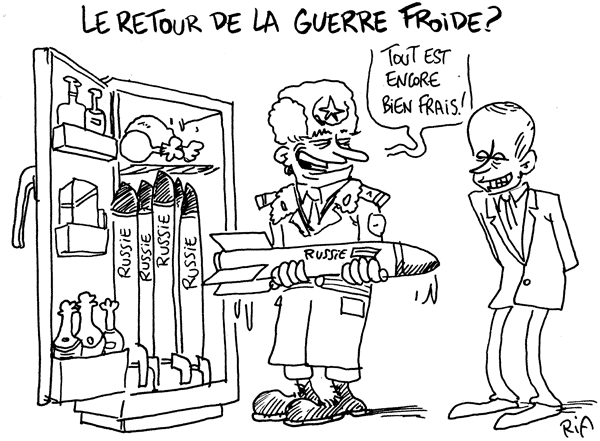Communiqué d'Amnesty International
Des éléments récemment découverts par Amnesty International indiquent que des membres du groupe armé qui se fait appeler État islamique (EI) ont lancé une campagne systématique de nettoyage ethnique dans le nord de l'Irak, commettant des crimes de guerre, notamment des enlèvements et exécutions sommaires de masse, contre les minorités ethniques et religieuses.
Parmi les minorités ethniques et religieuses prises pour cible dans le nord de l'Irak se trouvent les chrétiens assyriens, les chiites turkmènes et shabaks, les yézidis, les kakaïs et les mandéens sabéens. De nombreux Arabes et musulmans sunnites qui s'opposent, ou sont soupçonnés de s'opposer, à l'EI ont aussi été visés par ce qui semble être des attaques de représailles.
Un nouveau document, Ethnic cleansing on historic scale: the Islamic State’s systematic targeting of minorities in northern Iraq, présente des témoignages glaçants de personnes ayant survécu à des massacres.
MASSACRES ET ENLÈVEMENTS
Certains de ces récits décrivent la manière dont des dizaines d'hommes et de garçons de la région de Sinjar, dans le nord de l'Irak, ont été rassemblés par des combattants de l'État islamique, entassés dans des pick-up et conduits à l'extérieur de leur village pour être massacrés en groupe ou abattus individuellement. Des centaines de femmes et d'enfants, peut-être même des milliers, ainsi que des dizaines d'hommes appartenant à la minorité yézidie ont également été enlevés depuis que l'EI a pris le contrôle de cette zone.
Les massacres et les enlèvements auxquels procède l'État islamique prouvent une nouvelle fois qu'une vague de nettoyage ethnique visant les minorités balaye le nord de l'Irak.
Nous avons rassemblé des éléments prouvant que plusieurs massacres ont eu lieu dans la région de Sinjar en août. Deux des épisodes les plus sanglants sont survenus quand des combattants de l'EI ont lancé un raid sur les villages de Qiniyeh, le 3 août, et de Kocho, le 15. Pour ces deux seuls villages, le nombre de tués atteint plusieurs centaines. Dans les deux cas, des groupes d'hommes et d'adolescents, dont certains d'à peine 12 ans, ont été capturés par des activistes de l'EI, emmenés et abattus.
LES VICTIMES PRISES AU HASARD
« Il n'y avait pas d'ordre particulier, ils [les membres de l'EI] ont juste rempli les véhicules au hasard », nous a expliqué un survivant du massacre de Kocho.
Saïd, qui a échappé de justesse à la mort avec son frère Khaled, a reçu cinq balles. Trois dans le genou gauche, une dans la hanche et une dans l'épaule. Ils ont perdu sept frères dans le massacre. Un autre survivant, Salem, qui a réussi à se cacher et à survivre près du lieu du carnage pendant 12 jours, nous a décrit l'horreur d'entendre les cris de douleur des autres blessés.
« Certains ne pouvaient pas bouger et n'ont pas pu se sauver. Ils sont restés allongés là, à attendre la mort en souffrant atrocement. Ils ont eu une mort horrible. J'ai réussi à me traîner à l'écart et j'ai été sauvé par un voisin musulman. Il a risqué sa vie pour me sauver. C'est plus qu'un frère pour moi. Pendant 12 jours, il m'a apporté à manger et à boire toutes les nuits. Je ne pouvais pas marcher et n'avais aucune chance de pouvoir m'enfuir et ça devenait de plus en plus dangereux pour lui de me garder là », a-t-il expliqué.
Il a par la suite réussi à fuir à dos d'âne dans les montagnes, puis vers les zones contrôlées par le Gouvernement régional du Kurdistan.

UNE POPULATION TERRORISÉE
Les massacres et les enlèvements ont réussi à terroriser la totalité de la population du nord de l'Irak, poussant des milliers de personnes à fuir pour sauver leur vie.
On ignore toujours le sort réservé à la plupart des centaines de yézidis enlevés et maintenus captifs par l'État islamique. Nombre des personnes retenues par l'EI ont été menacées de viol ou d'agression sexuelle ou ont subi des pressions visant à les obliger à se convertir à l'islam. Dans certains cas, des familles entières ont été enlevées.
Un homme qui a fourni à Amnesty International une liste sur laquelle figuraient les noms de 45 de ses proches, uniquement des femmes et des enfants, a indiqué : « On a des nouvelles de certains d'entre eux, mais les autres ont disparu et on ne sait pas s'ils sont morts ou vivants ni ce qui leur est arrivé. »
La population du nord de l'Irak mérite de vivre libre de toute persécution sans avoir à craindre sans arrêt pour sa vie. Les donneurs d'ordre, les exécutants et les complices de ces crimes de guerre doivent être appréhendés et traduits en justice.
Depuis qu'ils ont pris le contrôle de Mossoul, le 10 juin, les activistes de l'EI ont aussi systématiquement détruit ou endommagé des lieux de culte autres que ceux de l'islam sunnite, y compris des mosquées et des temples chiites.