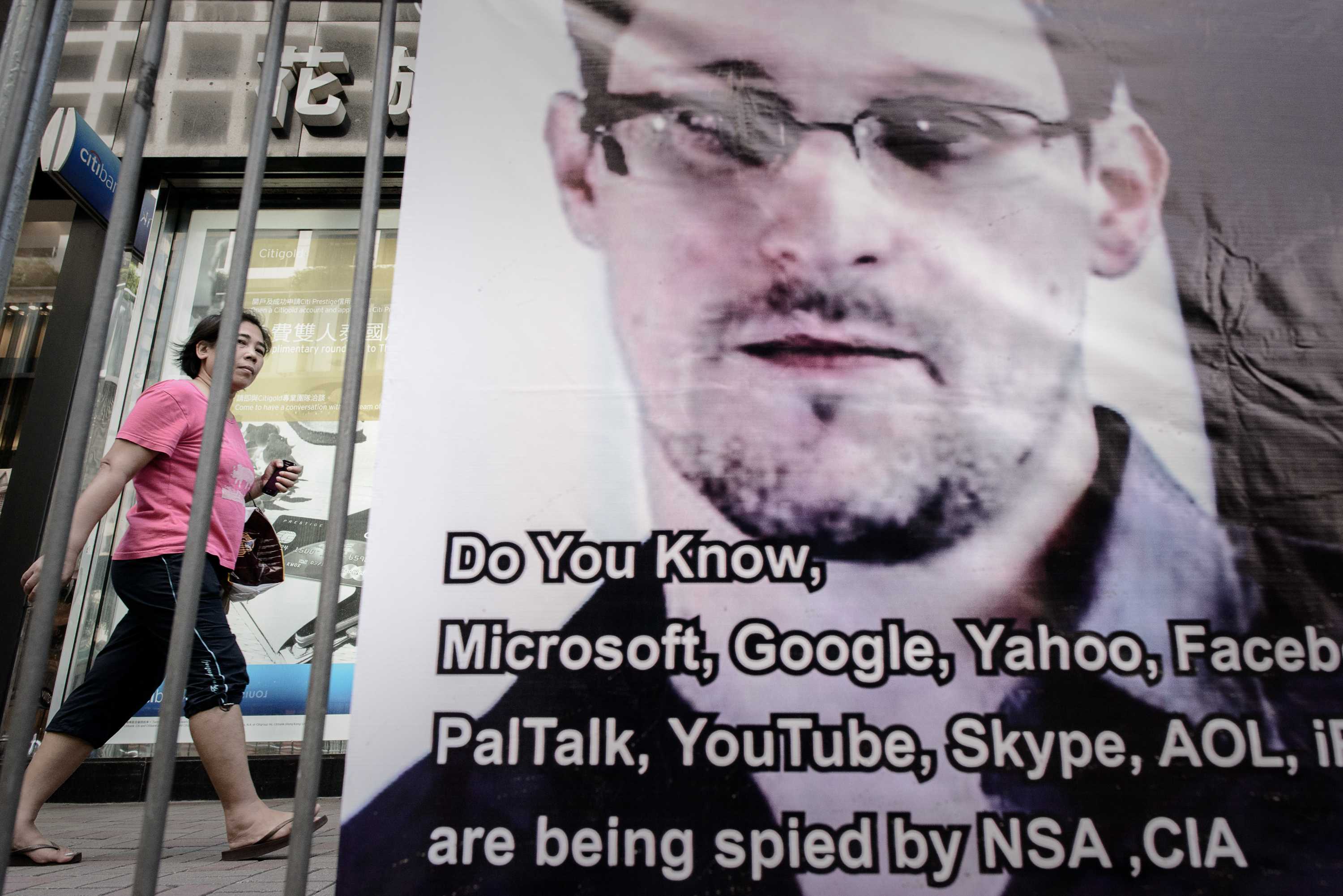Communiqué d'Amnesty International le 21/07/2014
L'offensive terrestre lancée par Israël dans la bande de Gaza, qui a commencé dans la nuit de jeudi 17 juillet après 10 jours d'attaques menées par les forces israéliennes et des groupes palestiniens armés, souligne la nécessité pour la communauté internationale d'agir de toute urgence afin de protéger les civils, à Gaza comme en Israël, de nouveaux crimes de guerre commis par les deux camps.
Lors des attaques aériennes incessantes d'Israël sur Gaza, les forces israéliennes ont fait preuve d'un mépris flagrant pour les vies et les biens civils, qui doivent être protégés en vertu du droit international humanitaire.
CHÂTIMENT COLLECTIF ET CRIMES DE GUERRE A GAZA
Selon le Bureau des Nations unies pour la coordination des affaires humanitaires (OCHA), 375 Palestiniens ont déjà été tués au 20 juillet à 15 heures ; au moins 270 sont des victimes civils, notamment 83 enfants et 36 femmes. Le dimanche 20 juillet a été la journée la plus sanglante depuis le lancement de l’offensive israélienne. Selon certaines sources, plus de 140 palestiniens auraient été tués dimanche portant le nombre de tués à plus de 500. Deux civils israélien ont été tués et 18 militaires.
Prendre des civils pour cible et mener des attaques directes contre des biens civils est injustifiable. Les deux camps, qui ont à de multiples reprises porté atteinte au droit international en toute impunité, doivent être amenés à rendre des comptes, et le premier pas dans cette direction est une enquête internationale diligentée par les Nations unies.
Plus de 1 780 logements ont par ailleurs été complètement détruits ou rendus inhabitables par les attaques israéliennes, et 10 600 résidents de Gaza se retrouvent sans domicile. Des biens civils israéliens ont également été endommagés par des roquettes tirées à l'aveugle depuis Gaza.
LES CIVILS SONT LES PREMIER TOUCHÉS
Huit membres d'une même famille ont été tués tôt le matin du 10 juillet lors d'une frappe aérienne sur le domicile de Mahmoud Lutfi al Hajj, dans le camp de réfugiés de Khan Younis (bande de Gaza). Plus de 20 voisins ont également été blessés lors de cette attaque, qui n'a été précédée d'aucune mise en garde particulière.
Prendre délibérément pour cible un logement civil est un crime de guerre, et la gigantesque ampleur de la destruction de logements civils, où se trouvaient dans certains cas des familles entières, fait apparaître un schéma inquiétant de violations répétées des lois de la guerre. Les autorités israéliennes n'ont fourni aucune information en relation avec des cas spécifiques afin de justifier ces attaques. Si elles ne sont pas en mesure de le faire, ces attaques constitueront des crimes de guerre et s'apparenteront à des châtiments collectifs.
LES INFRASTRUCTURES VITALES DE GAZA AU BORD DE L'EFFONDREMENT
Des frappes et des bombardements aériens israéliens ont par ailleurs causé de terribles dégâts au niveau des infrastructures des secteurs de l'eau et de l'assainissement à travers la bande de Gaza. Trois employés ont été tués alors qu'ils essayaient d'effectuer des réparations cruciales ; les hostilités incessantes ont rendu ce type de travail trop dangereux dans de nombreuses zones.
Les infrastructures de la bande de Gaza sont au bord de l'effondrement et les conséquences d'une privation durable d'eau propre pourraient être catastrophiques. Les dégâts infligés aux équipements d'évacuation et de pompage, et les risques de contamination des réserves d'eau en ayant résulté sont à l'origine d'une situation d'urgence sanitaire.
Au moins 22 900 civils ont été déplacés et un grand nombre d'entre eux ont trouvé refuge dans 24 écoles administrées par l'UNRWA à travers Gaza.
LE HAMAS ET LES GROUPES ARMÉS PALESTINIENS COMMETTENT DES CRIMES DE GUERRE
Le Hamas et les groupes armés palestiniens eux aussi font fi du droit international et mettent les civils en danger. Le 16 juillet, l'Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA) a découvert une vingtaine de roquettes dissimulées dans une école inoccupée de la bande de Gaza.
Les groupes armés palestiniens de la bande de Gaza ne doivent pas entreposer de munitions dans des zones résidentielles ni lancer d'attaques depuis celles-ci. L'aile militaire du Hamas et d'autres groupes armés palestiniens de Gaza, qui ont tiré plus de 1 500 roquettes à l'aveugle en Israël, doivent immédiatement mettre fin à ces crimes de guerre.
![]() Agissez pour les civils, premières victimes du conflit à Gaza. Participez à notre pétition photographique. PARTICIPEZ
Agissez pour les civils, premières victimes du conflit à Gaza. Participez à notre pétition photographique. PARTICIPEZ





 peut aussi aller chercher une notion comme le cas de force-majeur, de dire entre le moment où on a signé le prêt et le moment d’aujourd’hui, les conditions ont changées parce que les évènements internationaux ont une actualité qui va très vite. Et finalement, on estime que maintenant, on a plus à rembourser cette dette parce qu’on a plus les moyens de le faire ou parce qu’elle devient illégitime. Et puis simplement, la révolte d’un peuple peut aussi être une condition suffisante d’un peuple qui a dit « jusque là, on estime que le remboursement de la dette était légitime mais à partir d’aujourd’hui, vu la dégradation des conditions de vie, on estime que cette dette est illégitime ». Il y a cette notion d’illégalité de la dette mais il y a aussi cette notion d’illégitimité. Il faut déterminer si la dette est illégitime ou pas et pour ça, il n’y a pas d’autres idées que de faire un audit. C’est-à-dire qu’il faut demander exactement tous les contrats de prêt qui ont été signés, d’où vient cette dette, quelle histoire elle a, quelle origine elle a, qui sont ceux qui l’ont contracté. Pour faire quoi ? Parce ce qu’on peut très bien signer un contrat de prêt pour construire un hôpital mais est-ce qu’il y a eu un hôpital de construit ? Voilà, faire un audit très précis. La part qui est légitime et qui a servi au développement humain, bien sûr qu’elle doit être remboursée. Maintenant, la part illégitime qui aurait été détournée, qui aurait servie à construire des éléphants blancs, qui aurait servi à aider les entreprises étrangères et pas du tout à faire des infrastructures utiles pour les populations…cette part-là, elle est illégitime et il y a un bon fondement pour dire « on répudie cette part-là, on ne la rembourse pas. Nous maintenant, on garde l’argent, la richesse qu’on arrive à produire pour le développement humain de nos populations ».
peut aussi aller chercher une notion comme le cas de force-majeur, de dire entre le moment où on a signé le prêt et le moment d’aujourd’hui, les conditions ont changées parce que les évènements internationaux ont une actualité qui va très vite. Et finalement, on estime que maintenant, on a plus à rembourser cette dette parce qu’on a plus les moyens de le faire ou parce qu’elle devient illégitime. Et puis simplement, la révolte d’un peuple peut aussi être une condition suffisante d’un peuple qui a dit « jusque là, on estime que le remboursement de la dette était légitime mais à partir d’aujourd’hui, vu la dégradation des conditions de vie, on estime que cette dette est illégitime ». Il y a cette notion d’illégalité de la dette mais il y a aussi cette notion d’illégitimité. Il faut déterminer si la dette est illégitime ou pas et pour ça, il n’y a pas d’autres idées que de faire un audit. C’est-à-dire qu’il faut demander exactement tous les contrats de prêt qui ont été signés, d’où vient cette dette, quelle histoire elle a, quelle origine elle a, qui sont ceux qui l’ont contracté. Pour faire quoi ? Parce ce qu’on peut très bien signer un contrat de prêt pour construire un hôpital mais est-ce qu’il y a eu un hôpital de construit ? Voilà, faire un audit très précis. La part qui est légitime et qui a servi au développement humain, bien sûr qu’elle doit être remboursée. Maintenant, la part illégitime qui aurait été détournée, qui aurait servie à construire des éléphants blancs, qui aurait servi à aider les entreprises étrangères et pas du tout à faire des infrastructures utiles pour les populations…cette part-là, elle est illégitime et il y a un bon fondement pour dire « on répudie cette part-là, on ne la rembourse pas. Nous maintenant, on garde l’argent, la richesse qu’on arrive à produire pour le développement humain de nos populations ».