Attac et la fondation Copernic ont rendu public cet appel
Le gouvernement français s’apprête à engager une nouvelle réforme qui risque de porter un coup fatal au système de retraite par répartition en jurant une fois de plus que c’est pour le sauver. Le bilan des réformes menées depuis 1993 est déjà catastrophique car toutes les dispositions prises (calcul sur les 25 meilleures années, indexation sur les prix et non plus sur les salaires des actifs, allongement de la durée de cotisation sous peine de décote…) ont déjà fait baisser le niveau des pensions d’environ 20 %. Elles ont aggravé les inégalités déjà fortes entre les pensions des hommes et des femmes. Le Conseil d’orientation des retraites (COR) prévoit que le taux de remplacement moyen – niveau de la retraite par rapport au salaire, passerait de 72 % en 2007 à 59 % en 2050. Cette dégradation continuera donc de frapper les actuels retraités et touchera également les générations suivantes.
 Malgré ce bilan désastreux, le gouvernement veut aller encore plus loin en supprimant l’âge légal de départ à la retraite à 60 ans en le portant à 62, voire 65 ou 67 ans, comme le demande le Medef, et en remettant en cause le calcul sur les six derniers mois d’activité des retraites du secteur public. Jumelées avec un nouvel allongement de la durée de cotisation pour obtenir une retraite à taux plein, ces mesures condamneraient à la pauvreté la plupart des futurs retraités, surtout les femmes et tous ceux et celles qui ont connu et connaîtront des périodes de chômage et de précarité importantes. Ce sont les salarié-es les plus jeunes qui subiraient les effets cumulés de ces orientations au moment de partir à la retraite.
Malgré ce bilan désastreux, le gouvernement veut aller encore plus loin en supprimant l’âge légal de départ à la retraite à 60 ans en le portant à 62, voire 65 ou 67 ans, comme le demande le Medef, et en remettant en cause le calcul sur les six derniers mois d’activité des retraites du secteur public. Jumelées avec un nouvel allongement de la durée de cotisation pour obtenir une retraite à taux plein, ces mesures condamneraient à la pauvreté la plupart des futurs retraités, surtout les femmes et tous ceux et celles qui ont connu et connaîtront des périodes de chômage et de précarité importantes. Ce sont les salarié-es les plus jeunes qui subiraient les effets cumulés de ces orientations au moment de partir à la retraite.
Le gouvernement et le patronat persistent à vouloir durcir les conditions de départ en retraite alors même que les entreprises continuent de se débarrasser des salariés âgés avant qu’ils aient acquis la totalité de leurs droits. Exiger que les salariés travaillent et cotisent plus longtemps, alors que l’âge moyen de cessation d’activité est de 59 ans, ne vise qu’à baisser le niveau des pensions. De plus, cette logique remet en cause la solidarité intergénérationnelle. Il n’y a aucun sens à augmenter l’âge de la retraite alors que le chômage de masse sévit pour les jeunes. Au lieu de voir dans la retraite par répartition une transmission perpétuelle et solidaire de la prise en charge d’une génération par la suivante, le gouvernement et le patronat, afin d’attiser la division, la stigmatisent comme un fardeau pour la seule génération à venir.
Le danger ne s’arrête pas là. Le COR dessine les contours d’une réforme pour remplacer notre système par un autre « par points » ou « par comptes notionnels ». Dans les deux cas, il s’agirait de ne plus avoir à assurer un taux de remplacement du salaire défini à l’avance et de faire de la variation du niveau des pensions le moyen d’équilibre financier des régimes. Cela aggraverait encore la baisse du niveau des pensions et contraindrait les salariés, particulièrement les salarié-es pauvres et effectuant les travaux pénibles, à travailler toujours plus longtemps.
La vraie raison des mesures qui s’annoncent n’est pas liée à la démographie. La crise financière a provoqué une récession et donc une flambée des déficits publics. Les États continuent benoîtement à financer leurs déficits en empruntant sur ces mêmes marchés financiers qui ont provoqué la crise. Réduire ces déficits pourrait se faire par une taxation du capital. Mais les spéculateurs refusent évidemment cette solution, demandent que les États donnent des gages et exigent une réduction des dépenses publiques.
Une alternative à cette régression sociale existe pourtant. A moins de décréter la paupérisation des retraité-es, il est normal de couvrir les  besoins sociaux liés à l’augmentation de leur part dans la population par un accroissement des prélèvements sur la richesse produite. Les déficits des caisses de retraite sont essentiellement dus au refus obstiné de le faire. Pourtant, le besoin supplémentaire de financement nécessaire aux retraites est réalisable puisqu’il a été chiffré en 2007 par le COR entre 1 et 2 points de PIB jusqu’en 2050, à comparer avec la chute de la part de la masse salariale de 8 points au cours des dernières décennies et avec l’explosion correspondante des dividendes, qui sont passés de 3,2 % du PIB en 1982 à 8,5 % en 2007. Il est donc juste d’augmenter la part des salaires et des pensions dans la richesse produite en s’attaquant aux profits. Le financement des retraites est possible à condition d’en finir avec l’actuel partage éhonté de la richesse au bénéfice des revenus financiers. C’est ce partage qui constitue le tabou à faire sauter, et non l’âge de départ. Il s’agit là d’un choix politique de justice et de solidarité.
besoins sociaux liés à l’augmentation de leur part dans la population par un accroissement des prélèvements sur la richesse produite. Les déficits des caisses de retraite sont essentiellement dus au refus obstiné de le faire. Pourtant, le besoin supplémentaire de financement nécessaire aux retraites est réalisable puisqu’il a été chiffré en 2007 par le COR entre 1 et 2 points de PIB jusqu’en 2050, à comparer avec la chute de la part de la masse salariale de 8 points au cours des dernières décennies et avec l’explosion correspondante des dividendes, qui sont passés de 3,2 % du PIB en 1982 à 8,5 % en 2007. Il est donc juste d’augmenter la part des salaires et des pensions dans la richesse produite en s’attaquant aux profits. Le financement des retraites est possible à condition d’en finir avec l’actuel partage éhonté de la richesse au bénéfice des revenus financiers. C’est ce partage qui constitue le tabou à faire sauter, et non l’âge de départ. Il s’agit là d’un choix politique de justice et de solidarité.
La question des retraites pose celle de la société dans laquelle nous voulons vivre. Nous ne pouvons accepter la paupérisation programmée des futurs retraité-es, l’idéologie absurde du « travailler toujours plus » et la destruction des solidarités sociales.
Nous souhaitons contribuer à une vaste mobilisation citoyenne (réunions publiques, appels locaux…) pour stopper cet engrenage.
Pour signer l'appel, cliquer ici
Pour voir les signataires, cliquer ici



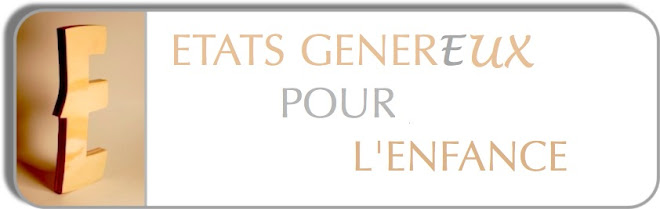
 En effet, a été notamment retenu le projet de « feuille de parcours [qui] trace l’ensemble des étapes par lesquelles passe l’enfant ». Cette logique de « suivi à la trace » n’est pas compatible avec la co-construction d’une confiance réciproque comme socle pour l’accompagnement de l’enfant en difficulté et de sa famille. De même est prévue l’instauration d’une « livret parental [qui] définira (…) les besoins de l’enfant (…) et les devoirs de chaque parent à son égard ». Là encore la logique de la « bonne parentalité », prescrite par des « experts », le rappel à l’ordre en matière de devoirs, l’emportent sur la volonté de mettre en place un accompagnement singularisé des parents par des professionnels attentifs.
En effet, a été notamment retenu le projet de « feuille de parcours [qui] trace l’ensemble des étapes par lesquelles passe l’enfant ». Cette logique de « suivi à la trace » n’est pas compatible avec la co-construction d’une confiance réciproque comme socle pour l’accompagnement de l’enfant en difficulté et de sa famille. De même est prévue l’instauration d’une « livret parental [qui] définira (…) les besoins de l’enfant (…) et les devoirs de chaque parent à son égard ». Là encore la logique de la « bonne parentalité », prescrite par des « experts », le rappel à l’ordre en matière de devoirs, l’emportent sur la volonté de mettre en place un accompagnement singularisé des parents par des professionnels attentifs. Loin de « sauver le système de retraite par répartition », comme le proclame le gouvernement, ce projet vise à offrir le marché des retraites aux assureurs, à rassurer les marchés financiers demandeurs de réduction des budgets publics et sociaux partout en Europe. Il n’assure pas la pérennité du système et ne répond pas aux vrais périls qui tiennent à la précarisation du travail et de l’emploi.
Loin de « sauver le système de retraite par répartition », comme le proclame le gouvernement, ce projet vise à offrir le marché des retraites aux assureurs, à rassurer les marchés financiers demandeurs de réduction des budgets publics et sociaux partout en Europe. Il n’assure pas la pérennité du système et ne répond pas aux vrais périls qui tiennent à la précarisation du travail et de l’emploi. Le 27 mai a été une grande journée de mobilisation tant au niveau national que local ....
Le 27 mai a été une grande journée de mobilisation tant au niveau national que local .... Six confédérations syndicales - CGT, CFDT, Unsa, Solidaires, FSU et CFTC - appellent à se mobiliser le 27 mai pour la défense des salaires, de l'emploi et des retraites, alors que le gouvernement doit présenter son projet de réforme d'ici la fin juin. Force ouvrière a décidé de son côté d'organiser une journée d'action le 15 juin sur la thème de la défense des retraites.
Six confédérations syndicales - CGT, CFDT, Unsa, Solidaires, FSU et CFTC - appellent à se mobiliser le 27 mai pour la défense des salaires, de l'emploi et des retraites, alors que le gouvernement doit présenter son projet de réforme d'ici la fin juin. Force ouvrière a décidé de son côté d'organiser une journée d'action le 15 juin sur la thème de la défense des retraites. Le jeudi 29 avril 2010, Dr. Carmaux est informée par un appel téléphonique à 19h30 que le C2 Sud va être fermé pour une durée de 15 jours. Le chef de service, Dr. Henry n’a pas été prévenu, la direction a peut-être attendu qu'il parte en congé... Le vendredi, les cadres supérieurs et la directrice des soins préviennent l’équipe et la cadre de la fermeture du service qui durera 15 jours et du redéploiement des infirmier(e)s et aides soignant(e)s dans les unités B4 Sud (-6 équivalents temps plein) et D3 Nord (-5 équivalents temps plein) à partir du lundi 3 mai 2010. L'équipe a du réorganiser le service afin que les 45 patients qui bénéficient de l’hospitalisation séquentielle soient maintenus 15 jours à domicile avec le soutien de l’équipe du centre médico-psychologique pour organiser des visites à domicile la semaine et le week-end. Il n’y a plus aucun lit sur l’hôpital, la situation est telle qu’on hospitalise des patients sur des lits de patients placés en isolement. Les patients vont mal, leur projet de soins a été brusquement interrompu, remplacé par une prise en charge de pis-aller !Au passage, on fait peser sur le personnel la responsabilité du devenir des patients, on les culpabilise.
Le jeudi 29 avril 2010, Dr. Carmaux est informée par un appel téléphonique à 19h30 que le C2 Sud va être fermé pour une durée de 15 jours. Le chef de service, Dr. Henry n’a pas été prévenu, la direction a peut-être attendu qu'il parte en congé... Le vendredi, les cadres supérieurs et la directrice des soins préviennent l’équipe et la cadre de la fermeture du service qui durera 15 jours et du redéploiement des infirmier(e)s et aides soignant(e)s dans les unités B4 Sud (-6 équivalents temps plein) et D3 Nord (-5 équivalents temps plein) à partir du lundi 3 mai 2010. L'équipe a du réorganiser le service afin que les 45 patients qui bénéficient de l’hospitalisation séquentielle soient maintenus 15 jours à domicile avec le soutien de l’équipe du centre médico-psychologique pour organiser des visites à domicile la semaine et le week-end. Il n’y a plus aucun lit sur l’hôpital, la situation est telle qu’on hospitalise des patients sur des lits de patients placés en isolement. Les patients vont mal, leur projet de soins a été brusquement interrompu, remplacé par une prise en charge de pis-aller !Au passage, on fait peser sur le personnel la responsabilité du devenir des patients, on les culpabilise. Malgré ce bilan désastreux, le gouvernement veut aller encore plus loin en supprimant l’âge légal de départ à la retraite à 60 ans en le portant à 62, voire 65 ou 67 ans, comme le demande le Medef, et en remettant en cause le calcul sur les six derniers mois d’activité des retraites du secteur public. Jumelées avec un nouvel allongement de la durée de cotisation pour obtenir une retraite à taux plein, ces mesures condamneraient à la pauvreté la plupart des futurs retraités, surtout les femmes et tous ceux et celles qui ont connu et connaîtront des périodes de chômage et de précarité importantes. Ce sont les salarié-es les plus jeunes qui subiraient les effets cumulés de ces orientations au moment de partir à la retraite.
Malgré ce bilan désastreux, le gouvernement veut aller encore plus loin en supprimant l’âge légal de départ à la retraite à 60 ans en le portant à 62, voire 65 ou 67 ans, comme le demande le Medef, et en remettant en cause le calcul sur les six derniers mois d’activité des retraites du secteur public. Jumelées avec un nouvel allongement de la durée de cotisation pour obtenir une retraite à taux plein, ces mesures condamneraient à la pauvreté la plupart des futurs retraités, surtout les femmes et tous ceux et celles qui ont connu et connaîtront des périodes de chômage et de précarité importantes. Ce sont les salarié-es les plus jeunes qui subiraient les effets cumulés de ces orientations au moment de partir à la retraite. besoins sociaux liés à l’augmentation de leur part dans la population par un accroissement des prélèvements sur la richesse produite. Les déficits des caisses de retraite sont essentiellement dus au refus obstiné de le faire. Pourtant, le besoin supplémentaire de financement nécessaire aux retraites est réalisable puisqu’il a été chiffré en 2007 par le COR entre 1 et 2 points de PIB jusqu’en 2050, à comparer avec la chute de la part de la masse salariale de 8 points au cours des dernières décennies et avec l’explosion correspondante des dividendes, qui sont passés de 3,2 % du PIB en 1982 à 8,5 % en 2007. Il est donc juste d’augmenter la part des salaires et des pensions dans la richesse produite en s’attaquant aux profits. Le financement des retraites est possible à condition d’en finir avec l’actuel partage éhonté de la richesse au bénéfice des revenus financiers. C’est ce partage qui constitue le tabou à faire sauter, et non l’âge de départ. Il s’agit là d’un choix politique de justice et de solidarité.
besoins sociaux liés à l’augmentation de leur part dans la population par un accroissement des prélèvements sur la richesse produite. Les déficits des caisses de retraite sont essentiellement dus au refus obstiné de le faire. Pourtant, le besoin supplémentaire de financement nécessaire aux retraites est réalisable puisqu’il a été chiffré en 2007 par le COR entre 1 et 2 points de PIB jusqu’en 2050, à comparer avec la chute de la part de la masse salariale de 8 points au cours des dernières décennies et avec l’explosion correspondante des dividendes, qui sont passés de 3,2 % du PIB en 1982 à 8,5 % en 2007. Il est donc juste d’augmenter la part des salaires et des pensions dans la richesse produite en s’attaquant aux profits. Le financement des retraites est possible à condition d’en finir avec l’actuel partage éhonté de la richesse au bénéfice des revenus financiers. C’est ce partage qui constitue le tabou à faire sauter, et non l’âge de départ. Il s’agit là d’un choix politique de justice et de solidarité.