Communiqué LDH
Le président du conseil scientifique de la Mission du centenaire de la Première Guerre mondiale, M. Antoine Prost, a remis le 1er octobre 2013 au ministre délégué auprès du ministre de la Défense un rapport intitulé « Quelle mémoire pour les fusillés de 1914-1918 ?
Un point de vue historien ». La Ligue des droits de l’Homme salue la qualité de ce travail, et se félicite de ce que les plus hauts responsables de la République ont choisi de se tourner vers des historiens pour éclairer leurs prises de décisions.
Ce rapport a le mérite de souligner que le terme de « fusillés » englobe plusieurs situations et plusieurs types de faits ; de fournir des données numériques et chronologiques à leur propos, ainsi que sur la disparité des archives conservées ; de rappeler l’importance, depuis la guerre, des mobilisations sur ce sujet, animées notamment par la LDH, et de nier qu’il aurait été tabou ou que la République n’aurait jamais voulu s’en saisir. A juste titre, il écarte la possibilité de tout nouveau procès en révision, et met en garde contre tout jugement anachronique sur une époque où la mort n’était pas perçue de la même façon qu’aujourd’hui ; il refuse toute instrumentalisation militante de cette question qui tendrait à la confondre ou l’assimiler à celles de l’antimilitarisme ou du pacifisme. Il a le mérite de conclure que la réintégration des fusillés dans la mémoire nationale, qui a fait de grand pas depuis le discours du Premier ministre Lionel Jospin en 1998, doit désormais passer par l’Histoire.
Reste que, pour la Ligue des droits de l’Homme, la réhabilitation ne peut pas être considérée comme achevée. Celle d’un certain nombre de victimes flagrantes d’injustice et d’arbitraire, dont plusieurs cas ont été défendus depuis longtemps par la LDH sans obtenir encore satisfaction, doit enfin aboutir. Elle ne peut consister en de simples déclarations ministérielles comme à propos du sous-lieutenant  Chapelant, le 11 novembre 2012. Selon la LDH, des décisions de cassation sans renvoi doivent, comme en 1906 dans le cas du capitaine Dreyfus, être prises simultanément sur un ensemble de cas emblématiques. Cette question n’est pas seulement liée à une période passée, elle renvoie à des problèmes actuels relatifs aux obligations et droits des militaires au sein des forces de défense françaises. Condamné à mort en juin 1917 pour refus d’obéissance en présence de l’ennemi, mais en réalité pour avoir joué le rôle de porte-parole dans un dialogue entre les hommes et les officiers, l’instituteur Paul Breton, dont le président du conseil Paul Painlevé a pris la défense et obtenu la grâce en Conseil des ministres, avait, en déclarant « Nous sommes dans une armée républicaine, que nous voulons républicaine », résumé un enjeu qui dépasse largement la guerre de 14-18.
Chapelant, le 11 novembre 2012. Selon la LDH, des décisions de cassation sans renvoi doivent, comme en 1906 dans le cas du capitaine Dreyfus, être prises simultanément sur un ensemble de cas emblématiques. Cette question n’est pas seulement liée à une période passée, elle renvoie à des problèmes actuels relatifs aux obligations et droits des militaires au sein des forces de défense françaises. Condamné à mort en juin 1917 pour refus d’obéissance en présence de l’ennemi, mais en réalité pour avoir joué le rôle de porte-parole dans un dialogue entre les hommes et les officiers, l’instituteur Paul Breton, dont le président du conseil Paul Painlevé a pris la défense et obtenu la grâce en Conseil des ministres, avait, en déclarant « Nous sommes dans une armée républicaine, que nous voulons républicaine », résumé un enjeu qui dépasse largement la guerre de 14-18.
La LDH souhaite également que, dans le cadre du centenaire de la Première Guerre mondiale, le travail historique sur ces questions soit encouragé. En particulier sur des problèmes qui lui tiennent à cœur depuis l’époque des faits, comme le sort des étrangers vivant en France, engagés volontaires affectés à des régiments de marche de la Légion étrangère, celui des « mauvais sujets » versés dans les « sections d’exclus », les « compagnies de discipline » ou victimes de la déportation judiciaire ou administrative dans des bagnes coloniaux, parmi lesquels il y eut probablement davantage de morts qu’il n’y eut de fusillés après condamnation d’un conseil de guerre aux armées. Au-delà de leur cas, ce centenaire doit être l’occasion d’avancer dans la connaissance historique du sort des cent quarante mille soldats de l’armée française morts durant le conflit, et qui n’ont pas eu droit à la mention « mort pour la France ».


 De nombreux livres et films ont traités de ce sujet : Pour l’exemple, Les sentiers de la gloire, Blanche Maupas, Un long dimanche de fiançailles…
De nombreux livres et films ont traités de ce sujet : Pour l’exemple, Les sentiers de la gloire, Blanche Maupas, Un long dimanche de fiançailles…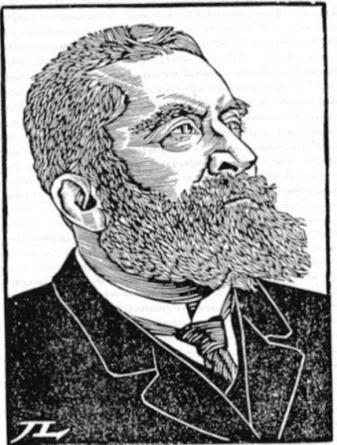
 force, depuis 2007, par la Libre Pensée, dont la LDH est proche et avec laquelle elle mène de nombreuses initiatives communes. Elle souhaite, quant à elle, qu’on ne se limite pas à une minorité de cas, les quelques 600 cas d’exécutions par fusillade après condamnation par un tribunal militaire. Il faut s’efforcer d’établir les faits sur le plus grand nombre possible des cas de fusillés pour l’exemple, y compris ceux, les plus nombreux, de militaires qui l’ont été sans condamnation judiciaire, ce qui ne peut être que le travail d’une commission dans la perspective du centenaire de 1914. Plus de 2 000 autres condamnations à mort ont été commuées en peines de travaux forcés ou « travaux publics », c’est-à-dire de déportation judiciaire dans les colonies, dont de nombreux soldats ne sont jamais revenus, tous comme d’autres, qui ont été condamnés directement à ces peines. En outre, surtout en 1917, des « mauvais sujets » (près de 2000 hommes ?) ont été prélevés au sein des régiments « mutinés », et victimes, sans jugement, de déportation dans les colonies. D’autres soldats, tout au long de la guerre, ont été victimes d’exécutions sommaires, qui paraissent particulièrement nombreuses parmi les étrangers engagés volontaires et les troupes coloniales.
force, depuis 2007, par la Libre Pensée, dont la LDH est proche et avec laquelle elle mène de nombreuses initiatives communes. Elle souhaite, quant à elle, qu’on ne se limite pas à une minorité de cas, les quelques 600 cas d’exécutions par fusillade après condamnation par un tribunal militaire. Il faut s’efforcer d’établir les faits sur le plus grand nombre possible des cas de fusillés pour l’exemple, y compris ceux, les plus nombreux, de militaires qui l’ont été sans condamnation judiciaire, ce qui ne peut être que le travail d’une commission dans la perspective du centenaire de 1914. Plus de 2 000 autres condamnations à mort ont été commuées en peines de travaux forcés ou « travaux publics », c’est-à-dire de déportation judiciaire dans les colonies, dont de nombreux soldats ne sont jamais revenus, tous comme d’autres, qui ont été condamnés directement à ces peines. En outre, surtout en 1917, des « mauvais sujets » (près de 2000 hommes ?) ont été prélevés au sein des régiments « mutinés », et victimes, sans jugement, de déportation dans les colonies. D’autres soldats, tout au long de la guerre, ont été victimes d’exécutions sommaires, qui paraissent particulièrement nombreuses parmi les étrangers engagés volontaires et les troupes coloniales. De nombreuses familles veulent savoir ce qu’il est advenu durant cette guerre à leurs ancêtres mobilisés qui n’ont pas eu la mention « mort pour la France ». 140 000 militaires français morts durant la guerre n’ont pas eu droit à la mention « mort pour la France ». Pour permettre que la vérité soit dite sur le plus grand nombre possible de faits et qu’intervienne le plus grand nombre possible de réhabilitations correspondant à toutes ces injustices, la LDH demande donc qu’une commission installée par une loi puisse donner aux familles le maximum de renseignements sur les circonstances de la disparition de soldats qui étaient leurs aïeux et permette que les condamnations arbitraires soient effectivement cassées sans renvoi.
De nombreuses familles veulent savoir ce qu’il est advenu durant cette guerre à leurs ancêtres mobilisés qui n’ont pas eu la mention « mort pour la France ». 140 000 militaires français morts durant la guerre n’ont pas eu droit à la mention « mort pour la France ». Pour permettre que la vérité soit dite sur le plus grand nombre possible de faits et qu’intervienne le plus grand nombre possible de réhabilitations correspondant à toutes ces injustices, la LDH demande donc qu’une commission installée par une loi puisse donner aux familles le maximum de renseignements sur les circonstances de la disparition de soldats qui étaient leurs aïeux et permette que les condamnations arbitraires soient effectivement cassées sans renvoi. La réhabilitation des victimes des tribunaux militaires de 14-18 est loin d’être achevée. Malgré les efforts de la Ligue des droits de l’Homme et d’autres associations qui ont permis d’annuler un certain nombre de condamnations, comme celle des « caporaux de Souain », dont l’instituteur Théophile Maupas défendu avec acharnement par sa veuve, Blanche Maupas, de nombreux soldats victimes d’injustices flagrantes n’ont pas été réhabilités.
La réhabilitation des victimes des tribunaux militaires de 14-18 est loin d’être achevée. Malgré les efforts de la Ligue des droits de l’Homme et d’autres associations qui ont permis d’annuler un certain nombre de condamnations, comme celle des « caporaux de Souain », dont l’instituteur Théophile Maupas défendu avec acharnement par sa veuve, Blanche Maupas, de nombreux soldats victimes d’injustices flagrantes n’ont pas été réhabilités.